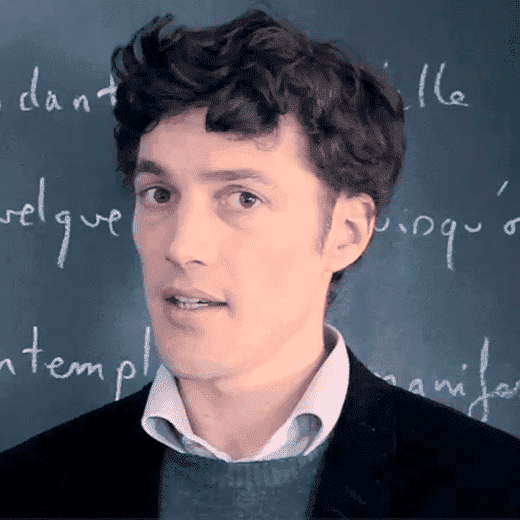L'énoncé
Dans cet exercice, nous allons voir ensemble combien un sujet peut contenir de réponses possibles. La force de ta problématique dépendra de ta capacité à trouver toutes les réponses que l’on peut apporter à une question.
Tu ne pourras donc jamais t’en tenir à une réponse en oui ou en non à une question en philosophie. Maintenant que tu sais repérer l’ambiguïté d’une question, le champ des réponses possibles doit vraiment s’ouvrir.
Cet exercice est le même que l'exercice 4, mais nous proposons des sujets un peu plus « larges », qui peuvent éventuellement contenir des ambiguïtés.
Pour les questions suivantes, dresse la liste exhaustive de toutes les réponses que l’on pourrait apporter à ces sujets.
Question 1
Pourquoi travailler ?
Ici la question semble plus générale et plus abstraite. Il faudrait dans l'idéal essayer de proposer une interprétation juste du sujet, afin de ne pas décentrer la question lors de la mise en place de la problématique.
La question « pourquoi travailler ? » interroge le sens que le travail apporte à notre existence. On pourrait donc répondre que le travail n'apporte pas de sens en lui-même, mais rend possible notre existence en nous donnant les moyens matériels nécessaires pour assurer notre subsistance. On pourrait en outre répondre que le travail donne bien du sens à notre existence, comme lorsque quelqu'un, par exemple exerce un métier passionnant. Le travail perd alors son aspect laborieux pour devenir une activité joyeuse.
Attention à ne pas confondre deux questions bien différentes. Il ne s’agit pas du tout ici de savoir « pourquoi les hommes travaillent ». Cette question se pose plutôt en première personne : c’est celui qui travaille qui interroge le sens de son activité.
Demande toi, en outre, quelle signification apporter à la question « pourquoi » ici. De manière générale, elle porte sur la cause, la raison, et la finalité.
Demande toi ce que le travail apporte à notre existence.
Question 2
Pourquoi des artistes ?
De même, en première lecture, la question semble ici très large. Il faut encore analyser le sujet pour permettre de cibler le problème qu'elle engage, et éventuellement exposer quelques éléments de résolution.
On pourrait donc dire que l'artiste crée parce qu'il en ressent le besoin, peut-être, par exemple, parce que le langage ordinaire ne lui permet pas d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Ces émotions, il les propose, il les laisse à la contemplation des spectateurs, qui peuvent plus ou moins y retrouver les leurs. Il y aurait donc, dans l'expérience de la contemplation d'une œuvre d'art, une expérience universelle.
On pourrait aussi avancer l'idée d'une fonction thérapeutique de l'art : par exemple, la musique aurait pour fonction de rendre certains sentiments exprimables, et ainsi de décharger les tensions accumulées dans l'âme du spectateur.
Une réponse plus radicale, mais qu'il ne faut pas laisser pour autant de côté, consisterait à dire que l'artiste n'assume aucune fonction particulière dans la société, et que la valeur de son activité ne peut pas se mesure à son utilité.
On peut interpréter la question de différentes manières ; d’abord, on peut comprendre le sujet simplement comme « pourquoi existe-t-il des artistes ? », et en ce sens, faire appel à une solution expliquant la fonction que peuvent occuper les artistes dans la société.
Mais on peut aussi comprendre ici la question comme une remise en cause de l’activité artistique : à quoi bon créer des œuvres d’arts ? Quel est l'intérêt de cette activité ?
Question 3
Le réel, est-ce seulement ce qui apparaît ?
La question semble, encore une fois très vaste. Il ne faut pas se laisser déstabiliser.
Nous appelons réel ce qui est l'ordre des choses par opposition à l'esprit qui les contemple. Le réel marque donc la distinction entre le sujet conscient, et ce sur quoi sa conscience se porte. Mais le réel se donne-t-il entièrement à la perception ? Celle-ci en effet pourrait déformer ou altérer le réel tel qu'il est en soi. Mais rien ne nous permet de décider si le réel est autre chose que ce qui apparaît car seule notre perception rend possible sa contemplation. Pourtant les sciences physiques prennent pour objet des éléments du réel dépassent l'ordre de l'observation (atomes, ondes, particules). Il doit donc bien y avoir quelque chose de plus que l'apparence sensible dans le réel.
Comme pour les autres questions qui ont été jusqu’ici posées, il faut avant toute chose analyser le sujet dans sa totalité. N’oublie pas que, bien souvent, une bonne compréhension du sujet se mesure par une attention minutieuse aux détails.
Ici la question admet que le réel apparaît et demande si le réel est aussi quelque chose de plus, qui dépasserait par conséquent l’ordre de l’apparence.
Ce que l'on aperçoit pas peut-il être réel ?