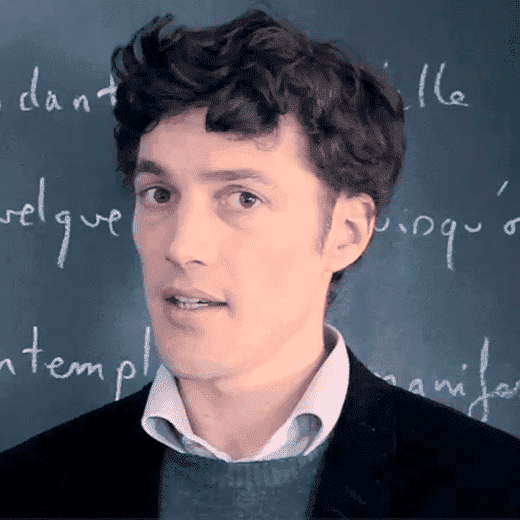L'énoncé
Dans cet exercice, nous allons voir ensemble combien un sujet peut contenir de réponses possibles. La force de ta problématique dépendra de ta capacité à trouver toutes les réponses que l’on peut apporter à une question.
Tu ne pourras donc jamais t’en tenir à une réponse en oui ou en non à une question en philosophie. Maintenant que tu sais repérer l’ambiguïté d’une question, le champ des réponses possibles doit vraiment s’ouvrir.
Pour les questions suivantes, dresse la liste exhaustive de toutes les réponses que l’on pourrait apporter à ces sujets.
Question 1
L'art modifie-t-il notre rapport à la réalité ?
Art et réalité semblent être deux domaines bien distincts. La réalité est de l'ordre de ce qui est immédiatement sous la main, il suffit de la dire ou de la décrire ; et à ce titre une œuvre d'art appartient à ce que nous appelons réalité. Au contraire, l'art est représentation, et bien souvent il fonctionne par images. En tant qu'art et réalité portent sur des objets différents, il n'y a aucune raison d'affirmer que l'art modifie notre rapport à la réalité.
Mais l'art modifie notre rapport à la réalité si l'on considère que la représentation d'une œuvre d'art nous affecte d'une manière ou d'une autre. Prenons l'exemple d'un film ou d'une pièce de théâtre dramatique : nous en sortons tristes, affectés, ou peut-être rassurés. Il s'agit bien dans une certaine mesure, d'une modification de notre rapport à la réalité.
Il ne faut bien sûr pas s’en tenir à une réponse par oui ou non ici. Je te conseille de varier tes réponses en fonction de ce que « modifier notre rapport à la réalité » signifie.
D’une manière ou d’une autre, ce sujet est ambigu. Tes réponses doivent mettre en valeur ces ambiguïtés.
L'art est dans la réalité, non ? Pourtant, l'art n'est pas la réalité, il en est une représentation, il ne peut pas avoir d'impact sur elle.
T'est-il arrivé après avoir lu un livre d'avoir une vision différente des choses ?
Question 2
Que gagne-t-on en travaillant ?
Il est bien évident qu'en premier lieu, le mot que l'on associe le plus volontiers à la notion de travail est le salaire. En travaillant, nous gagnons l'argent nécessaire, non seulement à notre subsistance, mais aussi à nos loisirs, à nos envies, à notre confort. Ce salaire est censé rétribuer le plus justement possible le travail exécuté.
Et pourtant, le travail apparaît aliénant à bien des égards : il représente très souvent une activité répétitive, fatigante, dont on ne cherche qu'à se débarrasser. De ce point de vue le salaire est, dans de nombreux métiers, une maigre rétribution. Le salarié est payé, certes, mais il perd une partie de lui-même dans le travail. Plus encore, le loisir, dans cette perspective, représente simplement le temps de repos nécessaire aux forces engagées dans le travail. Nous avons en ce sens tout à perdre dans le travail.
La notion de travail libérateur chez Hegel
Dans la « Dialectique du maître et de l'esclave », exposée dans La Phénoménologie de l'Esprit, Hegel formule la thèse d'un travail libérateur de la conscience humaine, qui serait cause d'un retour de la conscience humaine sur elle-même et ainsi d'une autonomie de l'esprit qui émancipe l'homme. Pour expliquer cette "prise de conscience", Hegel procède méthodiquement. Il décrit les diverses étapes de cette appropriation de la conscience par elle-même grâce au travail de l'homme, en exposant d'abord le rapport de l'homme à l'objet lorsqu'il n'est pas dans un cadre de travail, à travers la figure du maître, qui ne travaille pas ; puis en opposant à cette première situation celle du travailleur. Il en souligne alors les différences intrinsèques, avant d'expliquer la conséquence de ce rapport singulier que le travail instaure entre le travailleur et l'objet, en démontrant qu'il permet à la conscience de se révéler dans son indépendance. En travaillant à transformer le monde humain, l'esclave se transforme lui-même et parvient à renverser le rapport de domination maître-esclave, pour se retrouver dans l'accomplissement du monde humain : l'égalité.
Il serait absurde de répondre par oui et non à cette question. Par contre, en fonction de la perspective d’après laquelle on aborde le sujet, il peut en effet y avoir des réponses différentes.
Il est très conseillé de partir de la réponse qui te semble la plus évidente, c’est à dire celle qui te vient immédiatement à l’esprit.
Que gagne-t-on généralement quand on travaille ?
Perd-on quelque chose quand on travaille ?
Si tu connais la doctrine de Hegel sur le travail libérateur, c'est le moment de l'utiliser...
Question 3
Faut-il préférer le bonheur à la vérité ?
Il est d'usage de considérer l'ignorant comme un bienheureux, c'est-à-dire un être humain sachant se satisfaire de choses simples. Plus encore, nous parlons aussi du bien être de l'animal, qui ne fait que vivre sans se préoccuper des grandes questions scientifiques et philosophiques ; comme si la recherche de la vérité était une entrave au bonheur. Cette idée est renforcée, encore une fois par une image commune, celle de l'intellectuel malheureux, angoissé par les questions qu'il se pose. Pourquoi donc chercher vainement une vérité qui demeure, siècles après siècles, inaccessible ?
Et pourtant, si cette recherche anime le penseur, c'est qu'elle représente pour lui l'espoir d'un bonheur plus grand, plus étendu. Comme si comprendre pouvait satisfaire un désir premier : celui de connaître la vérité. Faut-il se détourner de ce désir de connaissance ?
Fais attention ici au verbe « préférer » qui représente ici l’axe autour duquel les notions de bonheur et de vérité vont s’articuler.
Tout comme dans l’exercice précédent, pars de la réponse la plus évidente pour y opposer immédiatement une critique provisoire.
"Heureux sont les simples d'esprit", as-tu déjà entendu cette expression ?
Et si connaître la vérité était un désir premier, propre à chaque homme ?
Question 4
Peut-on désirer sans souffrir ?
Le désir est un affect qui s'exprime comme une tendance vers un bien. Il est donc étrange de lier le désir et la souffrance. Cependant, le désir est rarement pleinement satisfait, il est souvent frustré. Et quand le désir se réalise, le plaisir de la possession disparaît en très peu de temps.
Tu l’as maintenant bien compris, il faut partir de la réponse la plus évidente que tu pourrais apporter au sujet.
Le sujet présuppose ici que le désir est la plupart du temps lié à la souffrance mais est-ce bien évident ?
Pense à ce qui se passe si le désir n'est pas pleinement satisfait.
Parfois, on désire quelque chose et quand on l'obtient, le désir disparait.