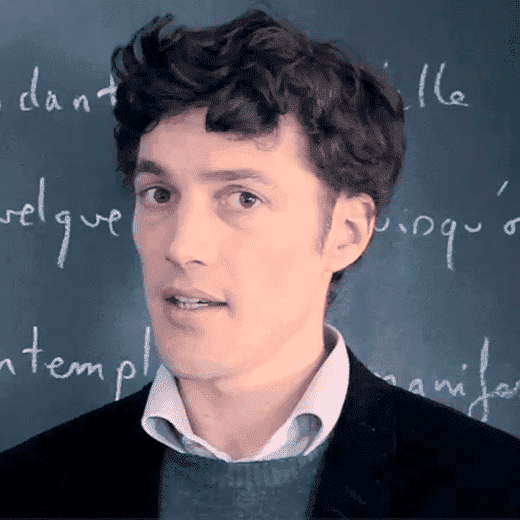L'énoncé
Pour les textes suivants, propose un découpage concis mettant bien en valeur le déploiement de l’argument de l’auteur.
Question 1
« Apprendre à se connaître est très difficile [...] et un très grand plaisir en même temps (quel plaisir de se connaître !) ; mais nous ne pouvons pas nous contempler nous-mêmes à partir de nous-mêmes : ce qui le prouve, ce sont les reproches que nous adressons à d'autres, sans nous rendre compte que nous commettons les mêmes erreurs, aveuglés que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, par l'indulgence et la passion qui nous empêchent de juger correctement. Par conséquent, à la façon dont nous regardons dans un miroir quand nous voulons voir notre visage, quand nous voulons apprendre à nous connaître, c'est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous découvrir, puisqu'un ami est un autre soi-même. Concluons : la connaissance de soi est un plaisir qui n'est pas possible sans la présence de quelqu'un d'autre qui soit notre ami ; l'homme qui se suffit à soi-même aurait donc besoin d'amitié pour apprendre à se connaître soi-même. »
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livre II, Chap. XV
Il y a trois grands moments dans ce texte d'Aristote.
- Un premier moment dans lequel l'auteur affirme la difficulté de se connaître soi-même, il faudra alors expliquer en quoi une telle connaissance est si difficile.
- Un second moment dans lequel Aristote affirme que l'on ne peut se connaître adéquatement que par le regard d'autrui.
- Un dernier moment qui sert à Aristote de conclusion, dans lequel Aristote affirme que nul homme ne se suffit à lui-même en matière de connaissance de soi.
Il est toujours bon de partir des connexions logiques pour bien établir le plan. Attention, tous les textes ne comportent pas de telles articulations. Il faudra alors s’appuyer sur le sens du texte.
Concentre-toi sur les articulations en gras dans le texte.
Question 2
« Maintenant habitue-toi à la pensée que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation et la mort est absence de sensation. Par conséquent, si l'on considère avec justesse que la mort n'est rien pour nous, l'on pourra jouir de sa vie mortelle. On cessera de l'augmenter d'un temps infini et l'on supprimera le regret de n'être pas éternel. Car il ne reste plus rien d'affreux dans la vie quand on a parfaitement compris qu'il n'y a pas d'affres après cette vie. Il faut donc être sot pour dire avoir peur de la mort, non pas parce qu'elle serait un événement pénible, mais parce qu'on tremble en l'attendant. De fait, cette douleur, qui n'existe pas quand on meurt, est crainte lors de cette inutile attente !
Ainsi le mal qui effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons la mort n'est pas là et lorsque la mort est là nous n'existons pas. Donc la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a pas d'existence pour eux, et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. Mais la plupart des gens tantôt fuient la mort comme le pire des maux et tantôt l'appellent comme la fin des maux. Le philosophe ne craint pas l'inexistence, car l'existence n'a rien à voir avec l'inexistence, et puis l'inexistence n'est pas un méfait. »
ÉPICURE, Lettre à Ménécée
Nous pouvons proposer le découpage suivant :
- L'importance d'être débarrassé de la crainte de la mort pour mener une vie heureuse.
- La mort semble être le plus grand des maux.
- Avantages liés à la dissolution de cette crainte.
- La mort n'est rien pour nous.
- Dissolution logique de cette crainte.
- Le bonheur est le fait de l'homme sage, qui a su triompher de sa peur de mourir.
Il y a beaucoup de connexions logiques dans ce texte. Il est en revanche déconseillé de proposer trop de parties argumentatives dans le texte. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier l’usage de sous-parties.
Essaye de considérer le texte dans sa totalité ; et de déceler ses plus grands moments (en gras dans le texte).