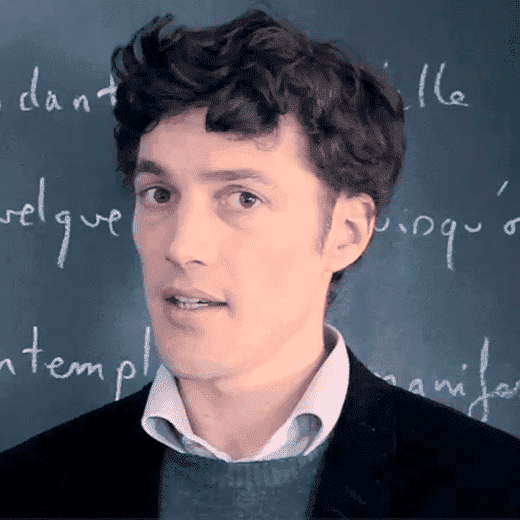L'énoncé
Publié en 1882, le Gai Savoir de Nietzsche est un texte présentant une addition d’aphorismes semblant n’obéir à aucun ordre spécifique. Mais malgré ce « chaos » apparent, on peut quand même déceler dans cet ouvrage une unité de pensée : il s’agit pour Nietzsche de s’attaquer aux préjugés qui se sont ancrés dans la connaissance humaine par l’habitude et surtout par l’absence d’une réelle attitude critique.
« Se trouver un travail pour avoir un salaire : voilà ce qui rend aujourd'hui presque tous les hommes égaux dans les pays civilisés ; pour eux tous le travail est un moyen et non la fin ; c'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Or, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans plaisir : ils sont délicats et difficiles à satisfaire, ils ne se contentent pas d'un gros gain lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. De cette espèce d'hommes rares font partie les artistes et les contemplatifs, mais aussi ces oisifs qui passent leur vie à la chasse ou bien aux intrigues d'amour et aux aventures. Tous cherchent le travail et la peine lorsqu'ils sont mêlés de plaisir, et le travail le plus difficile et le plus dur, s'il le faut. Sinon, ils sont décidés à paresser, quand bien même cette paresse signifierait misère, déshonneur, péril pour la santé et pour la vie. Ils ne craignent pas tant l'ennui que le travail sans plaisir : il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur travail réussisse. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce « calme plat » de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux ; il leur faut le supporter, en attendre les effets à part eux : voilà précisément ce que les natures inférieures n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes ! Chasser l'ennui à tout prix est aussi vulgaire que travailler sans plaisir. »
Nietzsche, Le Gai Savoir (extrait), §42
Question 1
Quel est le préjugé auquel s'attaque Nietzsche dans ce texte ?
Il est tout à fait commun d'associer l'idée de travail avec celle de labeur, c'est-à-dire une activité pénible demandant un effort soutenu et de longue haleine. Le travail conçu comme effort est le plus souvent motivé par le gain qui en résulte. C'est ce motif que Nietzsche prend pour cible ici : le travail ne doit pas être effectué pour le gain, mais au contraire, parce qu'il procure du plaisir. Ainsi ce n'est pas tant le but mais les raisons qui donnent au travail toute sa valeur. Autrement dit, il vaut mieux s'ennuyer que de travailler sans plaisir.
Pour trouver l’originalité de la thèse de Nietzsche, commence par te demander quelles sont nos opinions habituelles sur le travail.
Lis attentivement la section de texte qui apparaît en vert.
Question 2
Ce texte contient ici un paradoxe, lequel ?
Le préjugé auquel s'attaque Nietzsche peut être présenté différemment : l'auteur semble ici louer l'oisiveté et l'ennui comme préalables au seul travail qui vaille : le travail accompagné de plaisir. Or, non seulement il est courant de concevoir le travail comme labeur, comme effort, mais aussi de réprouver l'oisiveté, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, de ne pas avoir d'activité précise et productive. On pourrait donc affirmer ici que Nietzsche loue la paresse !
Demande toi ce qu’ont d’original les hommes décrits par Nietzsche dans le texte.
Concentre toi sur la section en bleu dans le texte.
Question 3
Définis le thème et l'objet central du texte.
Pour cela, souligne dans le texte les mots qui apparaissent le plus souvent puis définis ces notions.
« Se trouver un travail pour avoir un salaire : voilà ce qui rend aujourd'hui presque tous les hommes égaux dans les pays civilisés ; pour eux tous le travail est un moyen et non la fin ; c'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Or, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans plaisir : ils sont délicats et difficiles à satisfaire, ils ne se contentent pas d'un gros gain lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. De cette espèce d'hommes rares font partie les artistes et les contemplatifs, mais aussi ces oisifs qui passent leur vie à la chasse ou bien aux intrigues d'amour et aux aventures. Tous cherchent le travail et la peine lorsqu'ils sont mêlés de plaisir, et le travail le plus difficile et le plus dur, s'il le faut. Sinon, ils sont décidés à paresser, quand bien même cette paresse signifierait misère, déshonneur, péril pour la santé et pour la vie. Ils ne craignent pas tant l'ennui que le travail sans plaisir : il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur travail réussisse. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce « calme plat » de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux ; il leur faut le supporter, en attendre les effets à part eux : voilà précisément ce que les natures inférieures n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes ! Chasser l'ennui à tout prix est aussi vulgaire que travailler sans plaisir. »
On voit bien que le texte mêle trois notions principaux : le travail, l'ennui et le plaisir. Le travail est bien sûr le thème central du texte. Mais l'auteur y mêle les thèmes de l'ennui et du plaisir. L'ennui est la tonalité affective de l'homme au repos. On peut le définir comme une certaine souffrance : celle de ne pas savoir quoi faire. Mais l'ennui est présenté dans ce texte comme ce sans quoi le travail heureux est impossible. Il faut donc savoir s'y maintenir sans se divertir. Si le mot de plaisir nous semble être si évident, il convient de le définir : on peut le décrire comme un sentiment de plénitude lié à un bien être moral et physique.
Dans l’idéal, il faut définir ces notions en partant du langage commun, pour ensuite préciser leur sens dans ce texte particulier.
N’hésite pas à t’étendre un peu dans tes définitions. Il faut qu’elles soient claires ; et pour cela tu peux te répéter en changeant de perspective.
Question 4
Question un peu plus difficile : sous quel concept peut on placer tous les mots ici en gras ?
« Se trouver un travail pour avoir un salaire : voilà ce qui rend aujourd'hui presque tous les hommes égaux dans les pays civilisés ; pour eux tous le travail est un moyen et non la fin ; c'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Or, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans plaisir : ils sont délicats et difficiles à satisfaire, ils ne se contentent pas d'un gros gain lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. De cette espèce d'hommes rares font partie les artistes et les contemplatifs, mais aussi ces oisifs qui passent leur vie à la chasse ou bien aux intrigues d'amour et aux aventures. Tous cherchent le travail et la peine lorsqu'ils sont mêlés de plaisir, et le travail le plus difficile et le plus dur, s'il le faut. Sinon, ils sont décidés à paresser, quand bien même cette paresse signifierait misère, déshonneur, péril pour la santé et pour la vie. Ils ne craignent pas tant l'ennui que le travail sans plaisir : il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur travail réussisse. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce « calme plat » de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux ; il leur faut le supporter, en attendre les effets à part eux : voilà précisément ce que les natures inférieures n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes ! Chasser l'ennui à tout prix est aussi vulgaire que travailler sans plaisir. »
L'égalité, la finesse, la rareté, la délicatesse, l'insatisfaction, l'idée de nature inférieure, la vulgarité, sont des mots qui renvoient à l'idée de valeur. La vertu de l'homme consiste ici à ne travailler que par plaisir. Le vice, qui rend tous les hommes égaux dans la civilisation moderne est au contraire de travailler pour le gain qui en découle.
Prends une certaine distance par rapport au texte, relis le d’un trait en ne cherchant que des indices. Il s’agit ici d’avoir une vue d’ensemble sur le texte.
C’est là la difficulté de l’explication : savoir prendre de la distance par rapport au texte tout en respectant sa lettre. N’hésite pas à faire plusieurs tentatives sur ton brouillon.
Question 5
Dégager la question à laquelle répond l'auteur.
Du coup, on voit bien que Nietzsche traite ici de la question de la valeur du travail. Il répond à la question de savoir si l'homme est fatalement amené à considérer que le travail est un labeur, ou s'il existe au contraire une certaine attitude permettant à l'homme de pleinement se réaliser dans son travail.
Une fois que tu as bien compris le texte et ce que l’auteur soutient, tu peux en déduire la question qui le préoccupe ici. Cette question doit être énoncée clairement ; elle doit idéalement regrouper l’une des grandes problématiques abordée dans ton cours de terminale.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une question en philosophie n’est pas abstraite. Les auteurs se posent des questions que tout un chacun est en mesure de se poser. Cette question doit être simple : elle peut par exemple se présenter sous la forme d’une inquiétude.
Question 6
Dégager la réponse de l'auteur à cette question.
La bonne attitude face au travail est celle qui consiste à ne travailler que si cela nous procure du plaisir. Si tel n'est pas le cas, alors il faut attendre, c'est-à-dire s'ennuyer, jusqu'à ce que l'occasion d'un travail joyeux se présente. Au contraire, l'attitude qui consiste à travailler pour le gain est la négation de l'ennui qui est pourtant la marque de l'homme heureux.
Veille à ce que cette réponse prenne en compte tous les aspects de la question. C’est ici que la plupart des élèves prennent le risque de commettre un hors-sujet…
Tout est résumé dans la dernière phrase du texte.