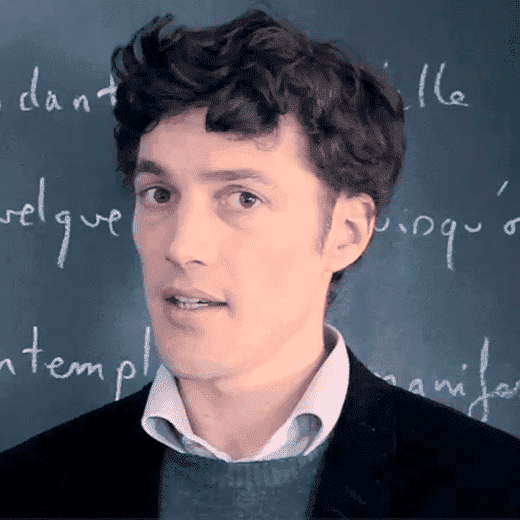L'énoncé
« Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé, pour l'arrêter comme trop prompt : si imprudents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si vains, que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue, parce qu'il nous afflige ; et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et, si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin : le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
PASCAL, Pensées, Brunschvicg 172 / Lafuma 47
Question 1
Quels est (sont) le(s) thème(s) abordé(s) dans ce texte ?
Ce texte de Pascal porte bien évidemment sur le temps. Mais on ne peut s'en tenir là. En effet, l'auteur met en relation ici la question du présent avec celle du bonheur. Ce serait traiter partiellement le texte que de se tenir à la notion de temps. Il faut bien faire attention à l'ensemble du texte, de la première à la dernière phrase.
Le thème d’un texte est ce sur quoi il porte. Normalement, tu dois pouvoir le raccorder à une ou plusieurs des grandes notions du programme de terminale.
En vert dans le texte.
Question 2
Quelle est la thèse que soutient Pascal dans ce texte ?
À la fin du texte, Pascal affirme que dans certaines conditions, le bonheur nous est inaccessible. Quelles sont ces conditions ? En ne nous tenant pas au temps présent, nous sommes davantage préoccupés par le passé et l'avenir. Or, le passé n'est plus, et l'avenir n'est pas encore. Le présent seul est donc la condition de possibilité du bonheur. L'homme par sa nature est incapable d'être heureux d'où le besoin de Dieu.
Il faut ici prendre le temps de relire le texte lentement en t’assurant de n’oublier aucun détail. Puis fais ensuite un pas en arrière et essaye de déterminer ce que l’auteur affirme ici.
Tu peux t’exercer à lire le texte à l’envers, phrase par phrase, pour mieux comprendre le déploiement de son argumentaire. En effet, les derniers moments d’un texte correspondent bien souvent à sa conclusion. À partir de celle-ci tu peux saisir comment l’auteur argumente son propos.
En rouge dans le texte.
Question 3
À quelle question répond ici l'auteur ?
Nous avons vu que Pascal affirmait qu'étant incapables de nous tenir au temps présent, le bonheur nous reste inaccessible. Il pose donc la question suivante : « Pourquoi ne sommes-nous jamais heureux ? »
Contrairement au thème et à la thèse de l’auteur, il arrive que la question à laquelle répond l’auteur ne soit pas présente dans le texte. Il faut donc à nouveau faire un pas en arrière et essayer de saisir le texte dans sa globalité.
Il faut procéder ici à l’envers. Une fois que tu as bien saisi ce que soutient ici l’auteur à propos de la relation entre le temps présent et le bonheur, tu dois transformer cette réponse en question. Plus simplement, si j’affirme que nous ne sommes pas libres d’agir comme nous le souhaitons, la question à laquelle je réponds est : « sommes-nous libres d’agir comme nous le souhaitons ? »
Question 4
La problématique. Dans la mesure du possible, essaye de montrer quels sont les problèmes posés par la thèse de l'auteur.
Réponses possibles :
- Qu'est-ce que se tenir au temps présent ? Comment se tenir au temps présent si celui-ci s'écoule sans cesse et reste, par là même, à jamais inaccessible.
- Doit-on penser que Pascal soutient ici que le bonheur est inaccessible, et que cela représente une fatalité ? Faut-il au contraire dire qu'il laisse entrevoir la possibilité du bonheur si l'on adopte la bonne attitude face au présent ?
- Pourquoi fuyons-nous le temps présent, en quoi nous afflige-t-il ?
- Si le présent nous afflige, en quoi pourrait-il constituer la condition au bonheur ?
- Se tenir au temps présent est-ce nécessairement être heureux ?
Nous verrons en détail cet exercice ultérieurement. Pour le moment, consigne par écrit toutes les étrangetés que tu peux déceler à propos de la thèse suivant laquelle, en ne nous tenant jamais au temps présent, le bonheur nous reste inaccessible.
Encore une fois, il faut ici se laisser aller. S’il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans ce texte, ce n’est pas dû à toi, mais à l’auteur lui-même, qui ne fait, dans un texte comme celui-ci, que nous transmettre l’ébauche d’une pensée.
Question 5
Structure du texte. Décompose le texte en parties distinctes.
Ici, tu peux associer entre eux les trois types de découpage suivants :
- Suivre l'ordre des paragraphes.
- Suivre les articulations logiques.
- Suivre le sens.
- Premièrement on peut découper en deux parties selon l'ordre des paragraphes.
- Mais tu remarqueras qu'il y a, dans le premier paragraphe, une articulation logique qui peut aisément passer inaperçue : « c'est que d'ordinaire le présent nous blesse ». Ici, Pascal explique pourquoi nous ne nous tenons jamais au temps présent. On peut donc découper deux sous-parties dans ce premier paragraphe, l'une consistant à énoncer, si l'on veut, un défaut inhérent à la nature humaine, l'autre, à expliquer l'origine de ce défaut.
- Dans le second paragraphe, il y a aussi une articulation : « ainsi nous ne vivons jamais ». « Ainsi » est la marque d'une conclusion : Pascal montre ici que le bonheur nous échappe, ce qui constitue la thèse principale du texte. On peut donc découper cette seconde partie en deux sous parties, l'une dans laquelle il fait appel à l'expérience personnelle du lecteur (« que chacun examine ses pensées »), l'autre, qui constitue la conclusion du texte.
Il y a plusieurs façons de découper un texte philosophique. La première, la plus intuitive, consiste à suivre l’ordre des paragraphes. La seconde consiste à suivre les articulations logiques (mais, car, or, en outre, etc.). Enfin la dernière, et si l’on veut la plus fine, à le découper en suivant son sens.
En bleu dans le texte.