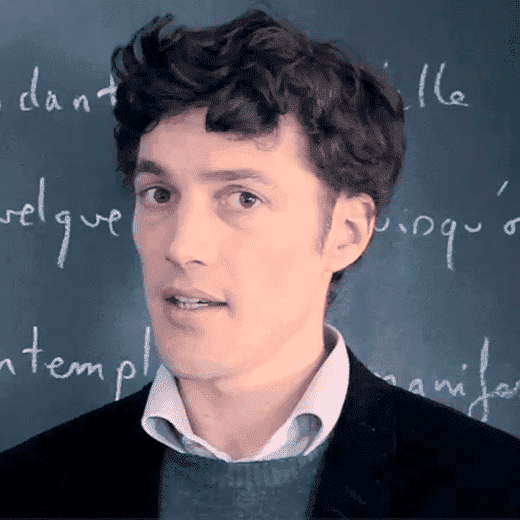L'énoncé
Trouve le problème que pose chacun des textes suivants.
Question 1
« Chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr et cet amour, cette haine, reflètent sa personnalité tout entière. Cependant le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes ; aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine, et des mille sentiments qui agitent l'âme. Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les avait ainsi fait descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Mais de même qu'on pourra intercaler indéfiniment des points entre deux positions d'un mobile sans jamais combler l'espace parcouru, ainsi, par cela seul que nous parlons, par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres et que ces idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent : la pensée demeure incommensurable avec le langage. »
Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience.
La thèse de l'auteur suppose tout simplement ici qu'il y a une différence entre le langage et la pensée, et donc qu'il existe une pensée non langagière. Or, d'expérience, il est facile d'observer que tout ce qui se trame dans notre esprit contient toujours du sens ; autrement dit que la pensée ne fonctionne que par le langage. Comment donc comprendre cette idée d'une pensée qui ne serait pas langage ?
Ici, Bergson se pose la question suivante : Pourquoi n’arrive-t-on jamais à exprimer adéquatement nos pensées ? À l’issue du texte Bergson propose la réponse suivante : Parce que la pensée demeure incommensurable avec le langage.
Pour poser le problème, il faut savoir :
- Ce que signifie « incommensurable » (tu dois pouvoir l’expliquer grâce au texte dans son ensemble).
- Essayer de déterminer ce que présuppose sa réponse du point de vue de la nature du langage, et de celle de la pensée.
Au sens propre, incommensurable signifie, sans commune mesure.
Question 2
« Dans le sommeil, je suis tout ; mais je n'en sais rien. La conscience suppose réflexion et division. La conscience n'est pas immédiate. Je pense, et puis je pense que je pense, par quoi je distingue Sujet et Objet, Moi et le monde. Moi et ma sensation. Moi et mon sentiment. Moi et mon idée. C'est bien le pouvoir de douter qui est la vie du moi. Par ce mouvement, tous les instants tombent au passé. Si l'on se retrouvait tout entier, c'est alors qu'on ne se reconnaîtrait pas. Le passé est insuffisant, dépassé. Je ne suis plus cet enfant, cet ignorant, ce naïf. À ce moment-là même j'étais autre chose, en espérance, en avenir. La conscience de soi est la conscience d'un devenir et d'une formation de soi irréversible, irréparable. Ce que je voulais, je le suis devenu. Voilà le lien entre le passé et le présent, pour le mal comme pour le bien.
Ainsi le Moi est un refus d'être moi, qui en même temps conserve les moments dépassés. Se souvenir, c'est sauver ses souvenirs, c'est se témoigner qu'on les a dépassés. C'est les juger. Le passé, ce sont des expériences que je ne ferai plus. Un artiste reconnaît dans ses oeuvres qu'il ne s'était pas encore trouvé lui-même, qu'il ne s'était pas encore délivré ; mais il y retrouve aussi un pressentiment de ce qui a suivi. C'est cet élan qui ordonne les souvenirs selon le temps. »
ALAIN, Manuscrits inédits, 1928 in Philosophie, Textes choisis pour les classes P.U.F. éd., tome II
Si le moi est la preuve du changement ; s'il est ce qui montre au sujet qu'il n'est plus ce qu'il a été, alors le sujet change tout le temps. Doit-on en déduire qu'il n'y a rien qui demeure dans la vie psychique de l'individu ? Doit-on affirmer alors que je ne suis jamais le même ? Si le moi est dynamique, alors qu'est-ce qui fonde l'identité du sujet ?
Ce texte porte sur la conscience et le temps. Dans ce texte l’auteur se demande ce qu’est le moi et quelle est son activité propre par rapport aux autres facultés de l’esprit comme la mémoire.
Pour l’auteur, la fonction de la conscience est de séparer ce qui est moi de ce qui ne l’est pas ou de ce qui ne l’est plus. Le moi est donc dans une constante dynamique : à chaque instant, il montre au sujet qu’il n’est plus ce qu’il a été.