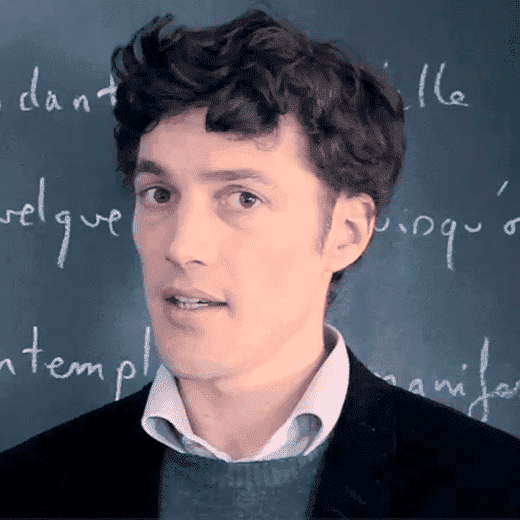L'énoncé
Nous allons nous entraîner à mettre en place une problématique. Par « problème » d’un texte, on peut entendre deux choses :
- Premièrement la question à laquelle répond l’auteur ; ou le problème soulevé par l’auteur.
- Deuxièmement, le problème que pose la thèse philosophique de l’auteur.
Dans chacun des textes qui suivent, essaye d’identifier et de construire la question soulevée par l’auteur. Encore une fois, cela te demande de prendre un peu de recul par rapport au texte. N’oublie pas : il ne faut pas trouver cette question, il faut la reconstruire par tes propres moyens.
Question 1
Commençons par un texte dans lequel il n'est pas difficile de dégager la question philosophique que se pose l'auteur :
« La différence décisive entre les outils et les machines trouve peut-être sa meilleure illustration dans la discussion apparemment sans fin sur le point de savoir si l'homme doit « s'adapter » à la machine ou la machine s'adapter à la « nature » de l'homme. Nous avons donné au premier chapitre la principale raison expliquant pourquoi pareille discussion ne peut être que stérile : si la condition humaine consiste en ce que l'homme est un être conditionné pour qui toute chose, donnée ou fabriquée, devient immédiatement condition de son existence ultérieure, l'homme s'est « adapté » à un milieu de machines dès le moment où il les a inventées. Elles sont certainement devenues une condition de notre existence aussi inaliénable que les outils aux époques précédentes. L'intérêt de la discussion à notre point de vue tient donc plutôt au fait que cette question d'adaptation puisse même se poser. On ne s'était jamais demandé si l'homme était adapté ou avait besoin de s'adapter aux outils dont il se servait : autant vouloir l'adapter à ses mains. Le cas des machines est tout différent. Tandis que les outils d'artisanat à toutes les phases du processus de l'oeuvre restent les serviteurs de la main, les machines exigent que le travailleur les serve et qu'il adapte le rythme naturel de son corps à leur mouvement mécanique. Cela ne veut pas dire que les hommes en tant que tels s'adaptent ou s'asservissent à leurs machines ; mais cela signifie bien que pendant toute la durée du travail à la machine, le processus mécanique remplace le rythme du corps humain. L'outil le plus raffiné reste au service de la main qu'il ne peut ni guider ni remplacer. La machine la plus primitive guide le travail corporel et éventuellement le remplace tout à fait. »
Hannah ARENDT, Condition de l'homme moderne, Chap. IV (l'oeuvre) éd. Calman-Lévy, coll. Presse Pocket, pp. 199-200
La question philosophique à laquelle Hannah Arendt apporte une réponse dans ce texte est la suivante : l'homme doit-il s'adapter à la machine ou la machine s'adapter à l'homme ? On pourrait encore poser la question de manière plus générale : l'homme doit-il s'adapter à ses moyens de production, ou les moyens de production doivent-ils s'adapter à l'homme ? Cette dernière formulation présente l'avantage de laisser intacte l'originalité de l'argument d'Hannah Arendt : l'outil est adapté aux mains de l'homme ; mais celui-ci doit en revanche s'adapter à la machine.
De quelle discussion parle Hannah Arendt au début du texte ? Pourquoi cette discussion est-elle « sans fin » ?
Nous allons dégager pour toi la thèse que soutient l’auteur dans ce texte : jusqu’ici l’homme, l’artisan, n’avait pas besoin de s’adapter à ses outils. Il construisait ses outils « sur mesure » pour sa propre production. Il n’en est pas de même concernant les machines : la machine est d’abord standardisée, elle est automatique, et produit des choses par elle-même. On peut penser ici au travail à la chaine illustré par Charlie Chaplin dans Les Temps modernes : l’homme est contraint de s’adapter au rythme de la machine.
Demande-toi donc maintenant : À quelle question philosophique générale cette thèse répond-elle ?
Question 2
Quelle est la question philosophique traitée par Rousseau dans le texte suivant ?
« Il n'y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des lois : dans l'état même de nature l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois : ils en sont les ministres, non les arbitres, ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles. »
ROUSSEAU, Lettres écrites de la montagne, VIII
La question philosophique soulevée par Rousseau dans le texte suivant pourrait être formulée ainsi : « la loi est-elle l'ennemie de la liberté ? » « La loi est-elle toujours contraignante ? », etc.
Demande toi d’abord quel est le thème du texte. Ici le thème réunit deux notions : la loi et la liberté. Quel rapport a-t-on coutume d’établir entre la loi et la liberté ?
Nous aurions tendance à dire que les lois sont une entrave à la liberté. Est-ce la thèse de Rousseau ici ?
Question 3
Quelle est la question philosophique soulevée par Leibniz dans le texte suivant ?
« Nous avons toujours des objets qui frappent nos yeux ou nos oreilles, et par conséquent l'âme en est touchée aussi sans que nous y prenions garde : parce que notre attention [est tendue vers] d'autres objets, jusqu'à ce que l'objet devienne assez fort pour l'attirer à soi en redoublant son action ou par quelque autre raison ; c'était comme un sommeil particulier à l'égard de cet objet-là, et ce sommeil devient général lorsque notre attention cesse à l'égard de tous les objets ensemble. [...] Toutes les impressions ont leur effet, mais tous les effets ne sont pas toujours notables : quand je me tourne d'un côté plutôt que d'un autre c'est bien souvent par un enchaînement de petites impressions dont je ne m'aperçois pas, et qui rendent un mouvement un peu plus malaisé que l'autre.
Toutes nos actions délibérées sont des résultats d'un concours de petites perceptions, et même nos coutumes et passions, qui ont tant d'influence dans nos délibérations, en viennent; car ces habitudes naissent peu à peu, et par conséquent, sans les petites perceptions, on ne viendrait pas à ces dispositions notables. [...] En un mot, c'est une grande source d'erreurs de croire qu'il n'y a aucune perception dans l'âme que celles dont on s'aperçoit. »
LEIBNIZ, Nouveaux Essais sur l'entendement humain
La question que soulève Leibniz dans ce texte est donc la suivante : sommes nous conscients de toutes les perceptions qui nous affectent ? Y-a-t-il des perceptions inconscientes qui déterminent, d'une manière ou d'une autre, notre volonté ?
Ce texte est un peu plus difficile. Demande-toi d’abord ce qu’affirme Leibniz dans ce texte ; il y est question par exemple de perception, de l’attention portée à ces perceptions ; de la volonté, etc.
Leibniz semble ici affirmer deux choses :
1) Nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous percevons (paragraphe 1).
2) Ces « petites perceptions inconscientes » inclinent notre volonté d’un côté ou de l’autre lorsqu’un choix se présente à nous.