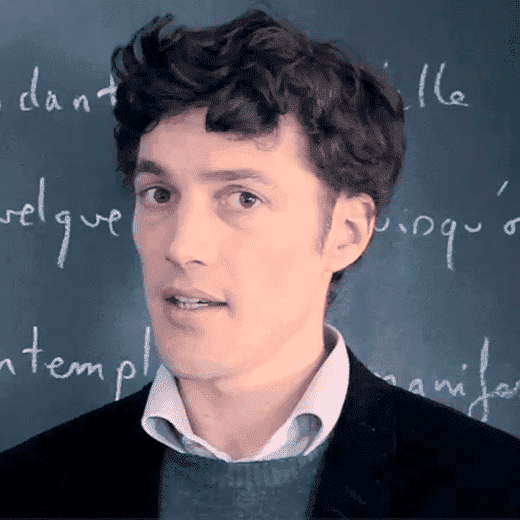L'énoncé
Nous allons maintenant nous entraîner à mettre en place une problématique. Par « problème » d’un texte, on peut entendre deux choses :
- Premièrement, la question à laquelle répond l’auteur ; ou le problème soulevé par l’auteur. Le problème, c’est la contradiction apparente sous-entendue par le texte, l’aporie, ce qui semble a priori indépassable, et qui, en ce sens, pose problème justement.
- Deuxièmement, la réponse au problème en question que donne l’auteur et que l’on appelle la thèse de l’auteur.
Nous allons pour l’instant nous concentrer sur la première des deux dimensions de la problématique. Une fois repéré le thème central du texte (et les notions qui sont mises en jeu), tu vas t’exercer à en déceler la question.
Texte 1 : Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience
Texte 2 : Alain, Manuscrits inédits.
Texte 3 : Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs
Texte 4 : Kierkegaard, Sur une tombe
Question 1
Quel est le problème soulevé par Bergson dans le texte suivant ?
« Chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr et cet amour, cette haine, reflètent sa personnalité tout entière. Cependant le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes; aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine, et des mille sentiments qui agitent l'âme. Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les avait ainsi fait descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Mais de même qu'on pourra intercaler indéfiniment des points entre deux positions d'un mobile sans jamais combler l'espace parcouru, ainsi, par cela seul que nous parlons, par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres et que ces idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent : la pensée demeure incommensurable avec le langage. »
Le texte porte sur le problème suivant :
Il est courant de définir le langage comme le moyen d'expression de la pensée. Par nature, le langage est composé de mots qui sont chacun compréhensibles par tous les individus partageant une même langue. En revanche, la pensée, les émotions, les sentiments sont vécus par des individus particuliers à un moment précis. Ils contiennent donc quelque chose d'irréductible, qui ne saurait être réduit à un mot qui, par sa capacité à être compris de tous, reste conceptuel. En ce sens, le mot, parce qu'il est concept et donc porte en lui-même une universalité, ne peut rendre compte de la spécificité du ressenti personnel de chacun.
L'auteur se pose donc la question suivante : pourquoi n'arrive-t-on jamais à exprimer adéquatement nos pensées ?
Le texte porte sur le thème du rapport de langage, qui reste le même pour tous les hommes, et la pensée qui, elle, est propre à chaque individu.
(En rouge dans le texte et en gras.) La réponse de l’auteur au problème que tu dois repérer est la suivante : « la pensée demeure incommensurable avec le langage », (dernière ligne).
Question 2
Quel est le problème soulevé par Alain dans le texte suivant ?
« Dans le sommeil, je suis tout ; mais je n'en sais rien. La conscience suppose réflexion et division. La conscience n'est pas immédiate. Je pense, et puis je pense que je pense, par quoi je distingue Sujet et Objet, Moi et le monde. Moi et ma sensation. Moi et mon sentiment. Moi et mon idée. C'est bien le pouvoir de douter qui est la vie du moi. Par ce mouvement, tous les instants tombent au passé. Si l'on se retrouvait tout entier, c'est alors qu'on ne se reconnaîtrait pas. Le passé est insuffisant, dépassé. Je ne suis plus cet enfant, cet ignorant, ce naïf. À ce moment-là même j'étais autre chose, en espérance, en avenir. La conscience de soi est la conscience d'un devenir et d'une formation de soi irréversible, irréparable. Ce que je voulais, je le suis devenu. Voilà le lien entre le passé et le présent, pour le mal comme pour le bien. »
« Ainsi le moi est un refus d'être moi, qui en même temps conserve les moments dépassés. Se souvenir, c'est sauver ses souvenirs, c'est se témoigner qu'on les a dépassés. C'est les juger. Le passé, ce sont des expériences que je ne ferais plus. Un artiste reconnaît dans ses œuvres qu'il ne s'était pas encore trouvé lui-même, qu'il ne s'était pas encore délivré ; mais il y retrouve aussi un pressentiment de ce qui a suivi. C'est cet élan qui ordonne les souvenirs selon le temps. »
Le texte porte sur le problème suivant. Il est courant d'identifier le moi comme l'ensemble de nos états de conscience. Il est ce qui perdure à travers le temps, ce qui reste le même. Cependant, mes pensées changent tout le temps : elles prennent tantôt la forme de souvenirs, tantôt celle d'une perception immédiate. Dans cette diversité d'états de conscience, qu'appelle-t-on le Moi ? Qu'est-ce qui demeure identique dans le changement de nos états intérieurs ?
Le thème du texte porte sur la conscience et le Moi.
Il est possible de déduire la question à laquelle répond le texte à partir de la thèse de l’auteur, (en rouge dans le texte).
Question 3
Quelle est la question à laquelle répond Kant dans ce texte ?
« Plus une raison cultivée s'occupe de poursuivre la jouissance de la vie et du bonheur, plus l'homme s'éloigne du vrai contentement. Voilà pourquoi chez beaucoup, et chez ceux-là mêmes qui ont fait de l'usage de la raison la plus grande expérience, il se produit, pourvu qu'ils soient sincères pour l'avouer, un certain degré de misologie, c'est-à-dire de haine de la raison. En effet, après avoir fait le compte de tous les avantages qu'ils retirent, je ne dis pas de la découverte de tous les arts qui constituent le luxe ordinaire, mais même des sciences, toujours est-il qu'ils trouvent qu'ils se sont imposé plus de peine qu'ils n'ont recueilli de bonheur : aussi à l'égard de cette catégorie plus commune d'hommes qui se laissent conduire de plus près par le simple instinct naturel et qui n'accordent à leur raison que peu d'influence sur leur conduite, éprouvent-ils finalement plus d'envie que de dédain. Et en ce sens il faut reconnaître que le jugement de ceux qui limitent fort et même réduisent à rien les pompeuses glorification des avantages que la raison devrait nous procurer relativement au bonheur et au contentement de la vie, n'est en aucune façon le fait d'une humeur chagrine ou d'un manque de reconnaissance envers la bonté du gouvernement du monde, mais qu'au fond de ces jugements gît secrètement l'idée que la fin de leur existence est toute différente et beaucoup plus noble. »
La question posée dans le texte est la suivante : on pourrait croire qu'il n'y a rien de plus souhaitable qu'un esprit cultivé. Il peut parfois même nous arriver d'envier une personne pour qui l'éloquence, la maîtrise des sciences et des arts ne font aucun défaut. Et pourtant, on voit naître chez ces hommes un certain malheur. En ce sens, Kant pose ici la question suivante : la culture nous éloigne-t-elle du bonheur ?
Pour trouver la question à laquelle répond l’auteur, essaye de repérer ce qu’il soutient, ce qu’il affirme. À partir de cette thèse, tu pourras en déduire la question à laquelle il répond.
Des indications en rouge dans le texte.
Question 4
Quelle est la question à laquelle répond Kierkegaard dans ce texte ?
« Le sérieux comprend que si la mort est une nuit, la vie est le jour, que si l'on ne peut travailler la nuit, on peut agir le jour, et comme le mot bref de la mort, l'appel concis, mais stimulant de la vie, c'est aujourd'hui même. Car la mort envisagée dans le sérieux est une source d'énergie comme nulle autre ; elle rend vigilant comme rien d'autre. La mort incite l'homme charnel à dire : " Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ". Mais c'est là le lâche désir de vivre de la sensualité, ce méprisable ordre des choses où l'on vit pour manger et boire, et où l'on ne mange ni ne boit pour vivre. L'idée de la mort amène peut-être l'esprit plus profond à un sentiment d'impuissance où il succombe sans aucun ressort ; mais à l'homme animé de sérieux, la pensée de la mort donne l'exacte vitesse à observer dans la vie, et elle lui indique le but où diriger sa course. Et nul arc ne saurait être tendu ni communiquer à la flèche sa vitesse comme la pensée de la mort stimule le vivant dont le sérieux tend l'énergie. Alors le sérieux s'empare de l'actuel aujourd'hui même ; il ne dédaigne aucune tâche comme insignifiante ; il n'écarte aucun moment comme trop court. »
La question à laquelle répond l'auteur dans ce texte est la suivante. La mort est un événement de la vie redouté par tous. Elle est décrite par l'auteur comme « la nuit » par opposition au jour qui représente la vie. La mort est l'horizon tragique de tout être humain. Mais est-ce une raison pour s'apitoyer sur son sort et attendre, les bras croisés, que celle-ci survienne ? Cet horizon tragique ne peut-il pas au contraire constituer un principe moteur, donnant à l'existence tout son sens ?
Comme pour les autres exercices, essaye de te concentrer sur ce que l’auteur affirme pour en déduire la question à laquelle il répond.
À l’aide du texte, essaye de répondre à la question suivante : qu’apporte l’idée de leur mort à l’homme charnel et à l’homme sérieux ?