L'énoncé
Ce QCM de cours porte sur les principaux enjeux des politiques éducatives depuis 1950 en France. Il n'y a qu'une seule bonne réponse par question.
Tu as obtenu le score de
Question 1
Laquelle de ces propositions n'est pas un objectif de l'école.
L'inculcation de savoirs et savoir-faire.
L'apprentissage du respect de la hiérarchie.
L'insertion sur le marché du travail.
Question 2
La massification scolaire correspond :
A l'augmentation du nombre d'étudiants et d'écoliers.
Au phénomène selon lequel chaque individu a de plus en plus de chances d'accéder aux formations souhaitées indépendamment de son origine sociale.
A une politique de correction des inégalités sociales dans le champ scolaire.
Un petit moyen mnémotechnique pour retenir la différence entre massification et démocratisation scolaire :
- Massification : on parle d'une masse, donc d'une quantité de personnes, indifféremment du niveau social ou du niveau scolaire.
- Démocratisation : on parle de démocratie, donc de citoyens égaux, donc on fait attention au niveau social et au niveau scolaire. Le but est que le niveau social n'influe pas sur le niveau scolaire.
Question 3
L'égalité des droits est un principe à l'origine de :
La massification scolaire.
L'égalité des droits ne prend pas en compte la condition sociale des individus. L'école est publique, gratuite, laïque et obligatoire indépendamment de l'origine sociale des enfants. C'est donc un des principes à l'origine de la massification scolaire.
La démocratisation scolaire.
La discrimination positive.
Question 4
Un système dans lequel chaque personne peut exercer le métier qu'elle souhaite en fonction des efforts qu'elle fournit est un système :
Démocratique.
Un système démocratique est un système dans lequel le peuple, électeur, choisit les personnes par un vote. Les révolutionnaires ont envisagé un temps, au XVIIIe siècle, de nommer les fonctionnaires par un système d'élection.
Népotique.
Un système népotique est un système dans lequel les personnes exerçant l'autorité favorise leur proche pour les nommer à des fonctions.
Méritocratique.
Un système méritocratique est un système dans lequel les postes s'obtiennent par le mérite des individus, les efforts qu'ils fournissent.
Question 5
Avec l'égalité des droits et la méritocratie, le troisième principe à l'origine de la massification scolaire est :
L'égalité des conditions.
L'égalité des chances.
L'égalité des sexes.
Plusieurs principes sont à l'origine de ces politiques. En premier lieu, il y a l'égalité des droits : l'école est publique, laïque, obligatoire et gratuite. Il y a également le principe de la méritocratie, qui veut que chaque personne puisse exercer le métier qu’il souhaite en fonction des efforts qu’il fournit : plus je fais d'efforts, plus je peux aller loin. Cette compétition est considérée juste si on respecte le principe de l'égalité des chances. Cela admet que l'on mette en place des dispositifs afin de permettre à tous d'avoir les mêmes opportunités ou chances au départ, indépendamment de caractéristiques telles que l'origine sociale, ethnique, le sexe, etc., qui sont des caractéristiques discriminantes.
Question 6
Le collège unique a été mis en place par :
La loi Berthoin en 1959.
La loi Haby de 1975.
La loi Haby, dite loi du collège unique, entend accueillir de plus en plus d'élèves dans les collèges, avec les mêmes programmes pour tous les élèves.
La loi Ferry de 1881.
Question 7
En 1959, la loi Berthoin :
Étend la scolarité obligatoire de 13 à 16 ans.
Crée le bac professionnel.
La mise en place du bac professionnel en 1985 suit la logique de permettre à tous d'accéder au bac.
Rend l'université gratuite.
Question 8
La démocratisation scolaire correspond :
A l'augmentation du nombre d'étudiants et d'écoliers.
Au phénomène selon lequel chaque individu a de plus en plus de chances d'accéder aux formations souhaitées indépendamment de son origine sociale.
A une politique de correction des inégalités sociales dans le champ scolaire.
Un petit moyen mnémotechnique pour retenir la différence entre massification et démocratisation scolaire :
- Massification : on parle d'une masse, donc d'une quantité de personnes, indifféremment du niveau social ou du niveau scolaire.
- Démocratisation : on parle de démocratie, donc de citoyens égaux, donc on fait attention au niveau social et au niveau scolaire. Le but est que le niveau social n'influe pas sur le niveau scolaire.
Question 9
Le fait que les individus issus de milieux plus défavorisés soient surreprésentés sur les parcours de types technologique ou professionnel est un exemple de :
Démocratisation scolaire.
Démocratisation limitative.
Démocratisation ségrégative.
A vouloir faire en sorte qu’il y ait un processus de massification scolaire, on aboutit peut-être un processus de démocratisation ségrégative. Par exemple, pour le bac, créer le bac pro, c'est créer une filière professionnelle. Il y a aussi une filière technologique qui existe depuis bien longtemps. Or, les individus dès le lycée vont être hiérarchisés en fonction de leur parcours. Il est des parcours qui sont beaucoup plus faciles ou qui sont moins prestigieux et ces parcours sont peu perméables entre-eux.
Les individus issus de milieux plus défavorisés sont surreprésentés sur les parcours de types technologique ou professionnel, et cela se répercute également dans le supérieur avec le clivage études courtes versus études longues. Il n'y a pas une réelle démocratisation scolaire.
Question 10
On mesure l'échec partiel de la démocratisation scolaire par :
Le taux d'inscription dans l'enseignement supérieur.
Les tables de mobilité.
Les tables de mobilité montrent les inégalités de trajectoire scolaire en fonction de la PCS d'origine du chef de famille.
Le taux de scolarisation.
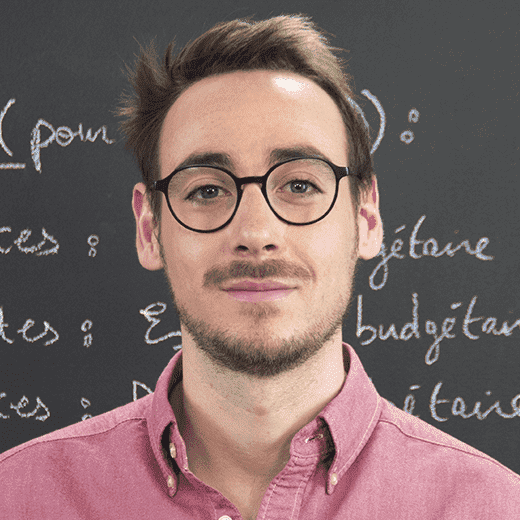
Il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler à l'école, qui correspond à un rapport entre "patron" et "ouvrier", ou "supérieur hiérarchique" et "salarié". Ce n'est pas la même chose qu'un rapport "prof"/"élève".